L’Anses dresse un état des lieux inédit de la contamination aux PFAS et recommande d’élargir la surveillance à 247 substances, bien plus que les 20 prévues par l’Europe en 2026.
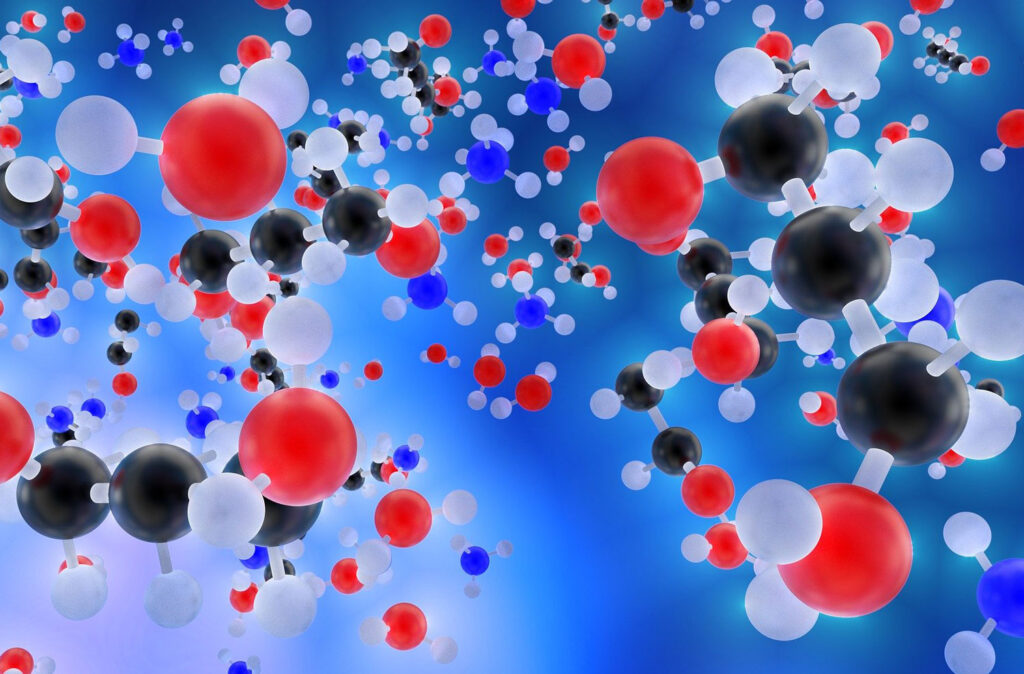
Un rapport monumental sur les polluants éternels
Après deux ans de travaux et près de deux millions de données analysées, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) publie ce 22 octobre 2025 un rapport de plus de 700 pages sur les PFAS, ces composés chimiques surnommés « polluants éternels ». Présents dans l’air, les sols, l’eau, les aliments ou même les cosmétiques, ces composés fluorés se caractérisent par une persistance extrême et une toxicité parfois avérée : troubles hormonaux, effets sur la fertilité, ou risque accru de cancers.
Ce nouveau rapport prolonge les travaux déjà évoqués dans notre article
« PFAS : tout ce qu’il faut savoir sur ces polluants éternels qui menacent notre santé »,
où nous expliquions en détail leur origine, leur usage industriel et leurs effets sur la santé.
Des substances omniprésentes et encore mal connues
Les PFAS sont utilisés depuis des décennies pour leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes et résistantes à la chaleur. On les retrouve dans les poêles antiadhésives, les textiles déperlants, les mousses anti-incendie ou certaines peintures industrielles. Leur diffusion est telle que 90 % des réseaux d’eau potable restent conformes, selon l’association Générations Futures, mais des traces sont détectées quasiment partout.

Dans plusieurs régions, les autorités ont déjà détecté la présence de PFAS dans l’eau du robinet. Nous avions détaillé les communes concernées dans notre enquête
« Polluants éternels : ces communes dont l’eau du robinet est contaminée ».
2 millions de données pour 142 PFAS analysés
Entre 2023 et 2024, l’Anses a compilé toutes les données françaises disponibles, issues des réseaux de surveillance, de la littérature scientifique, de Santé publique France (Études Esteban et Elfe) et du secteur industriel.
L’agence a pu évaluer les niveaux de contamination dans :
- les eaux destinées à la consommation humaine ;
- les sédiments et biotes ;
- les denrées alimentaires ;
- l’air et les poussières ;
- les matrices biologiques humaines (sang, urine, lait maternel).
Résultat : la France présente des concentrations comparables à la moyenne européenne, mais les données sur l’air et les sols restent insuffisantes.
Vers une surveillance élargie à 247 PFAS
Pour aller plus loin, l’Anses a développé une méthode de catégorisation combinant les données d’occurrence et de toxicité.
Cette approche conduit à recommander 247 substances à suivre, dont le TFA (acide trifluoracétique), un résidu persistant issu de pesticides, aujourd’hui absent des listes européennes.
Trois niveaux de suivi sont prévus :
- Surveillance pérenne : PFAS les plus fréquents et préoccupants.
- Surveillance exploratoire : molécules peu documentées.
- Surveillance localisée : autour des zones industrielles et anciennes usines de production.
Des manques persistants dans les données françaises
Comme le souligne Céline Drouet, directrice adjointe de l’évaluation des risques à l’Anses, « concernant leur présence dans l’air, les sols, les poussières ou l’exposition professionnelle, il y a très peu de choses ». Aucune donnée française n’existe sur les expositions professionnelles, et la plupart des informations sur l’air proviennent d’études européennes. L’agence recommande donc d’investiguer les matériaux au contact de l’eau, des aliments ou des matériaux de construction, afin d’évaluer leur potentiel de relargage.
L’Anses appelle à agir à la source
Si la surveillance doit s’intensifier, la priorité reste la réduction des émissions.
L’Anses soutient la restriction européenne des PFAS, actuellement en instruction à l’ECHA (Agence européenne des produits chimiques).
La question de la définition même des PFAS reste d’ailleurs au cœur des discussions européennes. Plusieurs scientifiques ont récemment dénoncé une tentative d’en restreindre la portée, comme nous l’expliquions dans notre article
« PFAS : des scientifiques dénoncent une tentative pour affaiblir leur définition réglementaire ».
L’objectif est de limiter la production et l’usage de toute la famille de PFAS, dont certains composés issus de médicaments ou de procédés industriels.
L’agence plaide également pour un dispositif national évolutif, capable d’intégrer régulièrement les nouvelles données de contamination et de toxicité. Elle encourage enfin une approche globale incluant d’autres polluants persistants : dioxines, PCB, HAP, métaux lourds, etc.
Un enjeu environnemental et sanitaire majeur
Les PFAS s’accumulent dans l’environnement et les organismes vivants. Leur lente dégradation les rend quasi indestructibles à l’échelle humaine. Face à ce constat, l’Anses appelle les pouvoirs publics à bâtir une stratégie pérenne : mieux surveiller, mieux comprendre, mais surtout prévenir.














